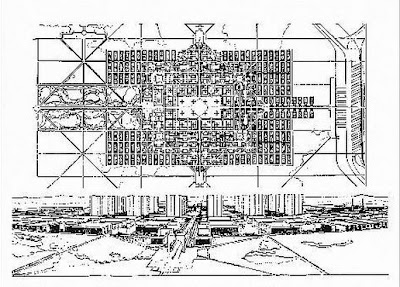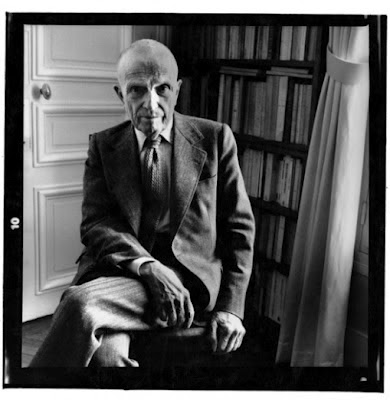|
| Les golfeurs - Dorothée Walter |
A travers la barrière, entre les vrilles des fleurs, je pouvais les voir frapper. Ils s’avançaient vers le drapeau, et je les suivais le long de la barrière. Luster cherchait quelque chose dans l’herbe, près de l’arbre à fleurs. Ils ont enlevé le drapeau et ils ont frappé. Et puis ils ont remis le drapeau et ils sont allés vers le terre-plein, et puis il a frappé, et l’autre a frappé aussi. Et puis, ils se sont éloignés et j’ai longé la barrière. Luster a quitté l’arbre à fleurs et nous avons suivi la barrière, et ils se sont arrêtés, et nous nous sommes arrêtés aussi, et j’ai regardé à travers la barrière pendant que Luster cherchait dans l’herbe.
— Ici, caddie ». Il a frappé. Ils ont traversé la prairie. Cramponné à la barrière, je les ai regardés s’éloigner.
— Écoutez-moi ça, dit Luster. A-t-on idée de se conduire comme ça, à trente-trois ans! Quand je me suis donné la peine d’aller jusqu’à la ville pour vous acheter ce gâteau. Quand vous aurez fini de geindre. Vous n’ pourriez pas m’aider à trouver ces vingt-cinq cents pour que je puisse aller voir les forains, ce soir?
Ils frappaient un peu, là-bas, dans la prairie. Je me suis dirigé vers le drapeau, le long de la barrière. Il claquait sur l’herbe brillante et sur les arbres.
— Venez, dit Luster. Nous avons assez cherché ici. Ils ne vont pas revenir tout de suite. Descendons au ruisseau pour trouver cette pièce avant que les nègres mettent la main dessus.
Il était rouge, et il claquait sur la prairie, et puis, un oiseau s’est approché, en diagonale, et est resté perché dessus. Luster a lancé. Le drapeau a claqué sur l’herbe brillante et sur les arbres. Je me cramponnais à la barrière.
— Quand vous aurez fini de geindre, dit Luster. J’ peux pas les faire revenir de force, hein? Si vous ne vous taisez pas, mammy n’ fêtera pas votre anniversaire. Si vous ne vous taisez pas, savez-vous ce que je ferai? J’ mangerai tout le gâteau. J’ mangerai les bougies aussi. J’ mangerai les trente-trois bougies. Venez, descendons au ruisseau. Faut que je trouve mon argent. Peut-être que nous trouverons une de leurs balles. Tenez, regardez, les voilà! Là-bas, au loin.» Il s’approcha de la barrière et montra avec son bras « Vous voyez. Ils n’ reviennent plus par ici. Venez. »
Nous avons longé la barrière et nous sommes arrivés à la clôture du jardin, là où se trouvaient les ombres. Mon ombre, sur la clôture, était plus grande que celle de Luster. Nous sommes arrivés à l’endroit cassé et nous avons passé à travers.
— Attendez une minute, dit Luster. Vous v’là encore accroché à ce clou. Vous n’ pouvez donc jamais passer par ici sans vous accrocher à ce clou?
Caddy m’a décroché et nous nous sommes faufilés par le trou. L’oncle Maury a dit qu’il ne fallait pas qu’on nous voie, aussi, nous ferons bien de nous baisser, dit Caddy. Baisse-toi, Benjy. Comme ça, tu vois? Nous nous sommes baissés et nous avons traversé le jardin où les fleurs grattaient et bruissaient contre nous. Le sol était dur. Nous avons grimpé par-dessus la barrière, là où les cochons grognaient et reniflaient. Je pense que c’est qu’ils ont de la peine, parce qu’on en a tué un aujourd’hui, dit Caddy. Le sol était dur, avec des mottes, des nœuds.
Garde tes mains dans tes poches, dit Caddy. Sans ça elles gèleraient. Tu ne voudrais pas avoir les mains gelées pour Noël, je suppose.
— Il fait trop froid dehors, dit Versh. Vous ne voulez pas sortir, voyons.
— Qu’est-ce qu’il a encore? dit maman.
— Il veut sortir, dit Versh.
— Laisse-le faire, dit l’oncle Maury.
— Il fait trop froid, dit maman. Il vaut mieux qu’il reste ici. Allons, Benjamin, tais-toi.
— Ça ne lui fera pas de mal, dit l’oncle Maury.
— Benjamin, voyons, dit maman, si tu ne te tiens pas comme il faut, je t’envoie à la cuisine.
— Mammy dit qu’elle ne le veut pas dans la cuisine aujourd’hui, dit Versh. Elle dit qu’elle a trop de choses à faire cuire.
— Laisse-le sortir, Caroline, dit l’oncle Maury. Tu te rendras malade à te tourmenter comme ça.
— Je le sais, dit maman. C’est le châtiment du bon Dieu. Parfois, je me demande.
— Je sais, je sais, dit l’oncle Maury. Il ne faut pas te laisser abattre. Je vais te préparer un toddy.
— Ça ne fera que m’agiter davantage, dit maman. Tu le sais bien.
— Tu te sentiras mieux après, dit l’oncle Maury. Couvre-le bien, petit, et mène-le dehors un moment.
L’oncle Maury est parti. Versh est parti.
— Tais-toi, je t’en prie, dit maman. On va te faire sortir le plus vite possible. Je ne veux pas que tu tombes malade.
Versh m’a mis mes caoutchoucs et mon pardessus, et nous avons pris ma casquette et nous sommes sortis. L’oncle Maury rangeait la bouteille dans le buffet de la salle à manger.
— Promène-le environ une demi-heure, dit l’oncle Maury, mais ne le laisse pas sortir de la cour.
— Bien m’sieur, dit Versh. Nous ne le laissons jamais sortir.
Nous sommes allés dehors. Le soleil était froid et brillant.
— Où donc que vous allez? dit Versh. Vous ne pensez pas que nous allons en ville? » Nous marchions dans les feuilles bruissantes. La grille était froide. « Vous feriez mieux de garder vos mains dans vos poches, dit Versh. Vous allez les geler sur cette grille. Et alors, qu’est-ce que vous ferez? Pourquoi que vous ne les attendez pas dans la maison? » Il a mis mes mains dans mes poches. Je pouvais l’entendre remuer dans les feuilles. Je pouvais sentir l’odeur du froid. La grille était froide.
— Tiens, v’là des noix. Chic! Grimpez à L’arbre. Regardez cet écureuil, Benjy.
Je ne pouvais pas sentir la grille du tout, mais je sentais l’odeur du froid brillant.
— Vous feriez mieux de garder vos mains dans vos poches.
Caddy marchait. Et puis elle s’est mise à courir. Son cartable sautait et dansait derrière elle.
— Bonjour, Benjy », dit Caddy. Elle a ouvert grille et elle est entrée, et elle s’est baissée. Caddy sentait comme les feuilles. « Tu es venu à ma rencontre, dit-elle. Tu es venu attendre Caddy? Pourquoi l’as-tu laissé se geler les mains comme ça, Versh ? »
— J’ lui ai dit de les mettre dans ses poches, dit Versh. Mais, à se cramponner comme ça à cette grille !
— Tu es venu attendre Caddy? dit-elle en me frottant les mains. Qu’est-ce qu’il y a? Qu’est-ce que tu essaies de lui dire, à Caddy? » Caddy sentait comme les arbres, et comme lorsqu’elle dit que nous dormions.
Pourquoi que vous geignez comme ça, dit Luster. Vous les reverrez quand nous arriverons au ruisseau. Tenez, voilà un datura. Il m’a donné la fleur. Nous avons passé à travers la clôture, dans le champ.
— Qu’est-ce qu’il y a? dit Caddy. Qu’est-ce que tu essaies de lui dire à Caddy? C’est eux qui l’ont fait sortir, Versh?
— On n’ pouvait pas le tenir à la maison, dit Versh. Il n’a pas eu de cesse qu’on n’ l’ait mis dehors. Et il est venu tout droit ici, regarder par la grille.
— Qu’est-ce qu’il y a? dit Caddy. Tu croyais peut-être que ça serait Noël quand je rentrerais de l’école. C’est ça que tu croyais? Noël, c’est après-demain. Le Père Noël, Benjy, le Père Noël! Viens, courons jusqu’à la maison pour nous réchauffer. » Elle m’a pris par la main et nous avons couru dans le bruissement des feuilles brillantes. Nous avons monté les marches en courant; et nous sommes entrés du froid brillant dans le froid noir.
Traduction : Maurice-Edgar Coindreau